La mémoire, comment la conserver par Pierre-Yves Jonin
Très grosse affluence (environ 200 personnes) pour cette conférence de début d’année.
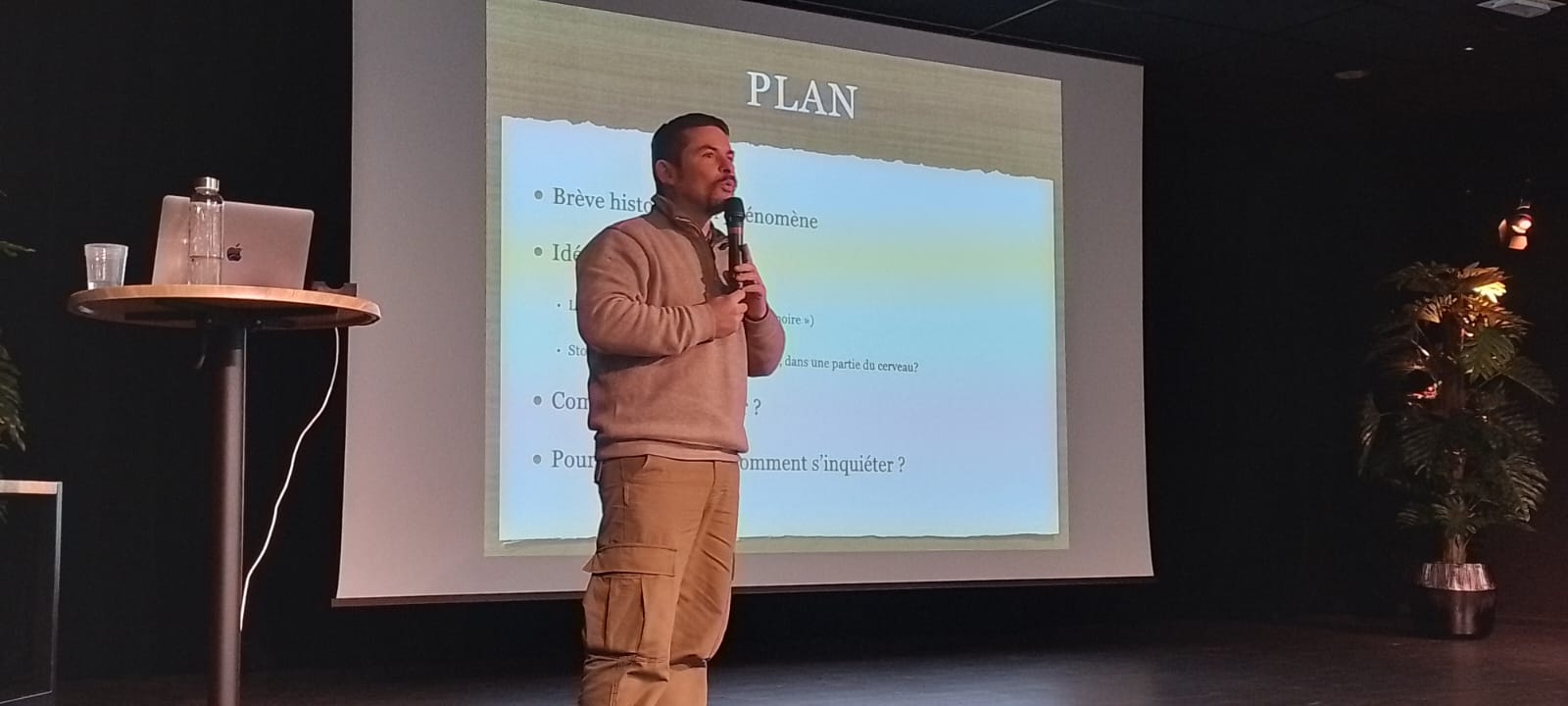

PY Jonin nous a démontré avec beaucoup de talent que l’âge n’est en rien la cause de perte de mémoire. Le lien social, le jardinage, l’alimentation (régime méditerranéen), la recherche de nouveaux défis (par exemple intégrer le CA de l’UTL), le sport sont des facteurs qui entretiennent la mémoire quelques soit l’âge. Les conseils en fin de conférence notamment sur le verre de vin rouge ont été très appréciés de nos adhérents. « Une conférence dont on se souviendra, mémorable ... »
Prochaine conférence le 28 Janvier avec le plan énergitique Négawatt

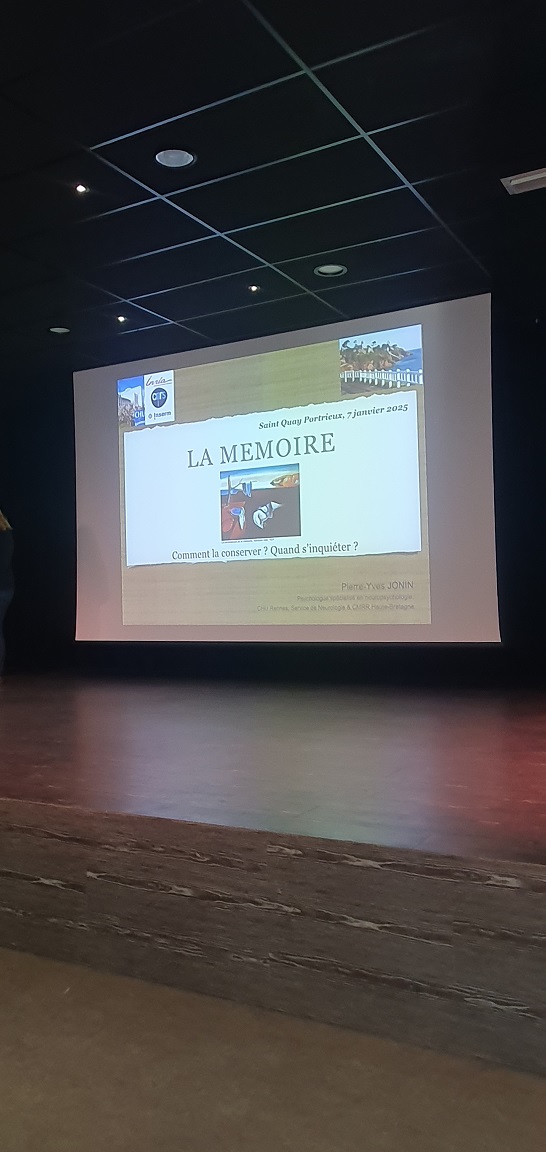

Merci à Gérard Drevet auteur du lignes ci-dessous
La mémoire, comment la conserver, quand s’inquiéter ?
Conférence UTL par Pierre-Yves Jonin, psychologue, chercheur, Dr en neuro-psychologie (notes GD)
Souvenons-nous de ce que disait Chateaubriand dans ses « Mémoires d’Outre-tombe » :
« Sans la mémoire, que serions nous ? »
Le cerveau est un gigantesque réseau de 100 milliards de neurones à l'origine de méta-circuits mnésiques. C'est un organe malléable à vie.
Les différents types de mémoire
. La mémoire « à court terme », c’est la mémoire de travail qui est au cœur du réseau.
. Les autres mémoires sont dites « à long terme » : ce sont
La mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont deux systèmes de représentation consciente à long terme.
La mémoire procédurale permet des automatismes inconscients.
La mémoire perceptive est liée aux différentes modalités sensorielles.
La mémoire associative est celle qui, partant d’un souvenir, y associe tout ce qu’il y avait autour.
Par ailleurs, on distingue souvent les mémoires explicites - dites déclaratives ou conscientes - (épisodique et sémantique) des mémoires implicites (procédurale et perceptive).
Notez que les différents types de mémoires sont omniprésentes quand on dort, ou qu’on décroche d’une situation donnée pour passer à une autre. On les perçoit à travers 3 verbes correspondant à 3 phénomènes précis :
Ressentir, c’est se souvenir de ce que l’on a perçu ou senti ;
Penser, c’est se souvenir, car la mémoire est le support de la pensée, elle est la fonction qui nous permet d’intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur ;
Aimer, c’est se souvenir avec plaisir d’une situation, d’une image, d’une sensation : c’est la « madeleine de Proust », dont le souvenir appelle à retrouver ce qu’il y avait tout autour, d’agréable et concomitant : à cette madeleine, prise dans un contexte précis, sont associés les gens, la maison, le village, etc. On est ici dans la mémoire associative.
Les différents types de mémoire :
La mémoire de travail (ou mémoire « à court terme ») est la mémoire du présent. Elle permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d’une tâche ou d’une activité.
Cette mémoire est sollicitée en permanence : c’est elle qui permet par exemple de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter, ou de retenir le début d’une phrase le temps de la terminer. Elle utilise une boucle phonologique (répétition mentale), qui retient les informations entendues, et/ou un calepin visuo-spatial, qui conserve les images mentales.
Elle nous permet de rassembler des idées qui se suivent pour une compréhension globale d’une relation ou d’un discours.
Elle fonctionne comme une mémoire tampon : les informations qu’elles véhiculent peuvent être rapidement effacées, ou bien stockées dans la mémoire à long terme par un système d’interactions spécifiques entre le système de mémoire de travail et la mémoire à long terme.
Sans mémoire à court terme, on ne peut plus enchaîner d’opérations ou faire de raisonnement, les données de départ ne sont plus accessibles pour la suite du processus de travail ou de pensée.
Les mémoires à « long terme »
- les mémoires explicites (sur des opérations conscientes à long terme) sont dites déclaratives
- La mémoire épisodique est celle des moments personnellement vécus (événements autobiographiques), celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l’espace et, ainsi, de se projeter dans le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux.
La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans. Elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment, à terme, en connaissances générales.
- La mémoire sémantique c’est elle qui définit les choses et nous fixe une idée ou une image, un nom, ou un sigle :
par exemple « la galette saucisse », chère à la Haute Bretagne (curieusement, on ne parle pas de galette mais de « crêpe salée » dans le Finistère). Ce simple mot de « galette » fait appel à une définition très précise et évoque une forme, une consistance, des couleurs, une saveur ….
- les mémoires implicites, dites aussi « non déclaratives » ou « intuitives »
Ce sont des mémoires qui s’expriment dans le « faire » : ainsi la mémoire perceptive offre à l’humain une capacité d’économie cognitive, qui lui permet de se livrer à des pensées ou des activités spécifiques tout en réalisant des activités devenues routinières.
- la mémoire dite procédurale : est la mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo ou jouer de la musique sans avoir à réapprendre à chaque fois. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c’est-à-dire inconsciente : la personne ne peut pas vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur ses skis ou descend sans tomber. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés.
La constitution de la mémoire procédurale est progressive et parfois complexe, selon le type d’apprentissage auquel la personne est exposée. Elle se consolide progressivement, tout en oubliant les traces relatives au contexte d’apprentissage (lieu, enseignant…).
- la mémoire perceptive s’appuie sur nos sens et fonctionne la plupart du temps à l’insu de l’individu. Elle permet par exemple de retenir des images ou des bruits sans s’en rendre compte. C’est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude, grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux ;
- la mémoire par amorçage, c’est l’association d’un comportement à des signaux : « je rencontre sur ma route le panneau « STOP » et agis suivant l’injonction qu’il représente » :
- la mémoire associative : quand parvient à votre oreille un nom, un slogan, une musique, (souvenez-vous de cette publicité : « Y-a bon … », la marque qui suit « … Banania » vous vient tout de suite à l’esprit) : on appelle ça des « déchets cérébraux », car ce sont des mémorisations par association sans l’avoir voulu . Et c’est devenu une technique de conditionnement classique chez les éducateurs ou … les publicistes.
Chassons les idées reçues
Il y a donc plusieurs formes de mémoire, mais ce ne sont pas des boites où l’on range ce qui est mémorisé, un stock passif de choses enregistrées.
Ni une caméra vidéo qui enregistre les choses que nous vivons, de façon à les retrouver plus tard.
On pourrait penser que le témoignage d’une personne honnête est basée sur une mémoire (et une restitution) fiable. Mais non, l’expérience a prouvé que l’on ne peut pas totalement s’y fier. D’ailleurs les experts n’y croient pas.
On pourrait penser que les souvenirs ne changent pas avec le temps : là aussi, c’est faux, car la mémoire n’est pas un enregistrement passif des choses que l’on vit, voit, entend.
Au contraire, on peut même influencer le témoignage d’une personne interrogée sur un fait vécu, simplement en fonction des mots utilisés dans la question posée au témoins. Ainsi une expérience présentée par le conférencier sur un accident de voiture en présence de témoins montre que, à la question « à quelle vitesse roulait la voiture tamponneuse lors du choc », le simple fait de parler de vitesse excessive ou de violence du choc va accroître la perception que le témoin va avoir de l’allure de la voiture impliquée … et fautive.
Tout simplement parce que, quand on sollicite un souvenir, on reconstruit tout autour un certain souvenir de ce qui semble logique d’être autour de l’événement que l’on se remémore. Car on n’a pas mémorisé ce qui était autour. Et donc, on complète inconsciemment un cadre probable, en rajoutant des à-côtés logiques et non mémorisés. Et la mémoire livre une vérité reconstruite par le cerveau quand il y a « des blancs » (des trous dans la mémorisation).
Ce qui veut dire que notre mémoire n’est pas très fidèle, et que l’on compense. Et dans les enquêtes policières, par exemple, on a pris cela en compte et beaucoup progressé dans la recherche de la vérité d’un événement ou d’une situation.
Le conférencier cite l’erreur de date faite par Nicolas Sarkozy citant sa participation à une journée vécue devant le Mur de Berlin en cours de démolition : les repères qu’il avait mémorisés ne lui permettait pas de citer une date précise. Mais dans son récit, il avait daté sa visite du jour-même où l’on avait commencé la destruction du mur, après l’effondrement de la RDA, alors qu’il n’était arrivé à Berlin qu’une semaine après. : il n’avait donc pas participé aux premiers coups de pioche, contrairement à ce qu’il disait (de bonne foi ?).
Il est aussi noté que sur 100 erreurs judiciaires constatées, 70 % des erreurs provenaient d’une charge erronée contre l’accusé, reposant sur des témoignages visuels directs.
Et les examens du cerveau sous IRM fonctionnel montrent qu’en phase de re-mémorisation, les zones du cerveau en activité (indiquant le réseau cérébral en action) sont les mêmes que lorsqu’on demande au patient d’imaginer un futur plausible.
Et les personnes qui ont de graves troubles de la mémoire sont aussi celles qui n’arrivent pas à se projeter dans le futur.
En conclusion, la mémoire n’est pas une machine à remonter dans le passé, mais plutôt à voyager dans le temps.
Comment la conserver ?
Des exercices pour améliorer sa capacité de mémoire ? l’expérience montre que les programmes de « Gym cerveau » ou « Comment conserver une mémoire au top en quelques minutes » que l’on trouve sur internet (il y en a des dizaines) partent de l’idée que « la mémoire ne s’use que si l’on s’en sert pas » et bâtissent leurs exercices autour de ce principe. Et, à l’examen après utilisation de ces programmes, les résultats réels d’amélioration de la mémoire sont très décevants.
En revanche la mnémotechnique, qui est vieille comme le monde, s’avère souvent très efficace pour se souvenir d’une suite d’actions à faire ou de noms à retenir.
On cite la méthode mnémotechnique des « loci » (les lieux en latin) citée par Cicéron, que l’on retrouve dans l’énumération « en 1er lieu », en 2ème lieu … » qui nous permet de dérouler différents points d’une argumentation.
Le principe de ce moyen mnémotechnique est d’imaginer visuellement un chemin ou un lieu que l’on connaît bien, et d’y placer, au fur et à mesure, des images censées nous rappeler les éléments d’une liste que l’on doit mémoriser. Par exemple, une liste de tâches à faire ou une liste de courses. Il suffit ensuite de re-parcourir mentalement ce cheminement – toujours dans le même ordre – pour retrouver les idées qui y ont été ancrées.
Imaginons que je dresse une liste de courses à faire et que je veux la mémoriser : chaque élément de ces courses va être associé (visuellement) à un endroit spécifique et bien connu du trajet que je vais faire, et l’incongruité de l’association va participer à la restitution : le potage en sachet sera associé à la clé que je vais tourner pour fermer la porte, la poubelle devant la porte aux fruits à acheter, etc … et pour restituer, je verrai la clé tournée dans le potage, ou les fruits jetés à la poubelle,…
Mais être en bonne santé est un atout pour conserver une bonne mémoire :
On recommande en particulier le régime Crétois qui réussit aux habitants de cette île grecque, chez qui on constate une autonomie exceptionnelle à un âge très avancé. Il est basé sur
une alimentation utilisant exclusivement des graisses végétales ;
des produits laitiers ou des viandes d’ovins et caprins ;
l’utilisation en cuisine de beaucoup d’aromates ;
la marche à préférer au déplacement en voiture ;
le jardinage partagé, qui est bon pour le corps et privilégie le travail en convivialité ;
une sieste tous les jours, et un bon sommeil la nuit d’une durée suffisante
favoriser les occupations en inter-générationnel, …
Quelques autres conseils pour conserver sa mémoire :
Faire des choses inhabituelles et relever des défis tout au long de sa vie ;
Rechercher la convivialité dans ses occupations ;
Entretenir une passion dans la lecture, la musique ou toute autre occupation artistique ;
Prendre des cours (de langues, par exemple) ;
Avoir des activités créatives ;
Pratiquer le bénévolat (en trans-générationnel, c’est un plus, car il faut sans cesse s’adapter) ;
Pourquoi s’inquiète-t-on de ses problèmes de mémoire ?
le moral est très corrélé à l’impression de perte de mémoire ;
vivre des fluctuations de notre moral a des incidences négatives sur la mémoire.
L’activité régulière et partagée à plusieurs est donc fondamentale.
Et l’on se heurte parfois à la discrimination liée à l’âge, qui est bien plus fréquente que les discriminations de race et de genre, avec des stéréotypes comme
les vieux sont sourds,
la solitude des vieux,
et tout cela amène à s’isoler et influe sur le moral et donc sur la mémoire.
« En vieillissant, on perd sa mémoire » est un stéréotype négatif qui pèse sur notre mental, et donc détériore nos activités physiques et de mémoire, ainsi que nos compétences : on a tout simplement été conditionné par le stéréotype.
Pour prévenir de futurs problèmes de mémoire, il faut essayer de fréquenter beaucoup de jeunes, plutôt que de rester entre vieux. C’est ainsi qu’une colocation inter-générationnelle peut être un gage de meilleure appréhension de nos problèmes d’âge, et rester « jeunes » (tout est relatif) plus longtemps .
Ainsi, on peut souligner les facteurs qui peuvent accélérer le vieillissement et la défaillance de la mémoire :
une alimentation trop chargée en sucres et en graisses ;
le fait de subir l’influence néfaste des stéréotypes ;
se détacher petit à petit des activités culturelles ;
exercer des professions stressantes ou trop routinières ;
manquer de sommeil ou sommeil de mauvaise qualité (apnée du sommeil, …)
subir une anxiété qui dure et stresse ;
alcoolisme, carences en vitamines, ..
être victime d’un syndrome dépressif ou d’un vécu douloureux ;
certaines pathologies du cerveau ;
une hérédité ou des gènes qui accélèrent le vieillissement ;
la sous-utilisation des fonctions cognitives ;
un manque d’activité physique ;
une humeur induite par des chutes de moral ou des agressions psychiques, …
Ne pas s’alarmer des freins constatés à nos capacités essentielles de la vie courante :
difficulté à trouver ses mots dans une conversation ;
difficulté à faire plusieurs choses en même temps ;
avoir besoin de faire répéter ;
ne plus savoir ce qu’on est venu faire en changeant de pièce ;
moins se souvenir de la façon de faire en situation de tâches multiples ou d’interférences ;
Car tout cela procède d’un vieillissement normal de nos capacités.
Mais alors quand faut-il s’inquiéter ?
Lors de changements inattendus dans nos capacités :
constater des oublis véritables de choses importantes et connues, malgré de l’aide ;
des phénomènes de désorientation (on ne retrouve plus son chemin) ;
une incompréhension des mots de la langue courante ;
une confusion entre les mots ;
dire un mot pour un autre, …
une perte d’information sur des noms connus ou face à des visages (qui est-ce ?) ;
Et dans ces cas-là, il faut consulter, d’abord son médecin généraliste, qui vous orientera vers un neurologue pour une consultation « mémoire » avec un psychologue, pour une batterie de tests psychologiques, permettant de faire des recommandations, voire des examens complémentaires (IRM , …).
Pour le moment, il n’y a pas de médicaments qui guérissent, mais on peut ralentir la dégradation, et choisir soi-même une stratégie pour freiner cette évolution, en fonction des propositions des soignants.
----------------------
En réponse à des questions au conférencier, il faut noter que :
la vraie mémoire qui n’est que visuelle ne dure que très peu de temps ;
l’hérédité dans la maladie d’Alzheimer n’explique que de 1% des cas diagnostiqués ; en revanche il semble que l’origine génétique (modification d’un gène) soit probable.
les dernières recherches sur la maladie d’Alzheimer (cela mériterait un plus large développement) montrent qu’elle est induite par une dégénérescence des neurones au niveau de l’hippocampe (zone centrale du cerveau), et indiquent qu’elle est déclenchée
soit par une anomalie du métabolisme de l’amyloïde-β (plaques de fragments de protéines), amenant une dégénérescence des synapses inter-neuronaux sur lesquels elle se dépose.
soit par des dégénérescences neuro-fibrillaires, du fait de la modification chimique d’une protéine tau hyper-phosphorisée surabondante, amenant une dégénérescence des neurones eux-mêmes (protéine tau qui joue un rôle clé dans le soutien interne et le transport des nutriments au sein des neurones).
Ces anomalies sont en fait produites plusieurs années (10 à 20 ans) avant qu’on en constate les effets visibles chez le patient ;
Et les traitements efficaces consisteraient à nettoyer ces plaque amyloïdes.
Mais il y a autant de formes de maladie d’Alzheimer que de patients !
Influence des AVC sur la mémoire (attention au tabac et à l’alcool !) :
2 types d’AVC : l’AVC ischémique qui survient lorsqu’un caillot de sang bouche un vaisseau sanguin du cerveau ; l’AVC hémorragique lorsqu’il y a rupture d’une artère du cerveau.
Dans le 1er cas, l’impact sur la mémoire est plus fréquent, mais dépend de la zone du cerveau qui n’a pas été irriguée. Beaucoup moins dans le second cas.
Pour en savoir plus, un site web vous propose un autre exposé très construit :
< https://www.inserm.fr/dossier/memoire>